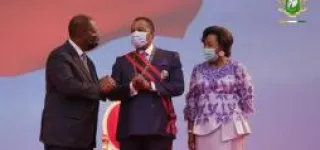Présentée comme un plaidoyer en faveur d’une démocratie apaisée à l’approche de la présidentielle de 2025, cette déclaration, en apparence vertueuse, trahit pourtant de profondes incohérences.
Plutôt que d’adopter un ton clair et résolu, cette déclaration s’enfonce dans un registre flou et consensuel, comme si l’institution juridique redoutait par-dessus tout de se faire entendre trop distinctement.
Le silence étrange face aux attaques contre la CEI
Mais, où donc était le Barreau lorsque la Commission Électorale Indépendante (CEI), pilier fragile mais fondamental de notre édifice républicain, se voyait publiquement vilipendée, traînée dans la boue des suspicions partisanes, accusée sans preuve surtout, avec une verve soigneusement mise en scène par une opposition en quête de bouc émissaire.
Le Barreau était-il en retraite spirituelle ou absorbé dans un long silence méditatif sur la neutralité judiciaire ?
Ce silence, aussi bien ajusté questionne cependant.
Au nom de quel article, de quel code ou de quelle convenance peut-on garder la bouche close quand une institution cardinale de notre démocratie se fait décapiter symboliquement sous les vivats des foules numériques et des responsables de l’opposition ?
Me Tompieu Messan, porte-parole du Barreau, le même qui, en avril 2025, avait accepté de porter une requête visant à radier Alassane Ouattara de la liste électorale, se réclamant alors défenseur du droit, ne devrait-il pas, avec la même rigueur, s’ériger aujourd’hui en protecteur de la légalité constitutionnelle et du fonctionnement régulier des institutions ?
Où sont donc passées les prérogatives fondamentales du Barreau sur la défense de l’intérêt général, la protection des principes républicains, la promotion de la justice équitable ?
En détournant pudiquement le regard de cette campagne d’affaiblissement institutionnel, et en préférant discourir de manière vague sur des ombres et des lutteurs anonymes, le Barreau abdique une partie de sa mission.
Il ne s’agissait pas de choisir un camp, mais de choisir la loi. Et dans cette équation, le mutisme devient presque une complicité passive.
Des libertés évoquées, sans les défendre
Que dire de cette allusion brumeuse aux « arrestations nocturnes », et « les atteintes à la liberté syndicale « sont évoquées du bout des lèvres comme si elles relevaient d’un conte urbain, d’une légende politique racontée à la lumière vacillante d’un néon judiciaire.
A les lire, on croirait presque, que ce sont des ombres qui arrêtent des ombres, sans genre, sans nom, sans voix, sans témoin, comme si les libertés publiques se volatilisaient d’elles-mêmes, par caprice météorologique.
Mais n’est-ce pas là encore une pirouette d’éloquence creuse pour ne pas froisser ?
Une façon élégante, mais inoffensive, de mentionner des faits graves sans jamais convoquer le moindre responsable ?
La justice, disait-on, ne devait pas être un théâtre d’ombres. Pourtant, c’est bien un théâtre d’allusions que le Barreau a monté, distribuant les rôles sans jamais nommer les acteurs.
Car enfin, si ces enlèvements sont réels et il semble que le Barreau le pense, pourquoi ne pas s’en émouvoir avec la clarté qu’exige la gravité ?
Pourquoi ne pas exiger des enquêtes publiques, dénoncer haut et fort les atteintes à l’intégrité physique et morale des citoyens, et identifier, au moins institutionnellement, les forces politiques qui instrumentalisent la rue tout en pleurant l’oppression ?
L’élégance du flou contre la rigueur du droit
En invoquant la liberté tout en taisant les vérités dérangeantes, le Barreau se heurte à un paradoxe inquiétant : vouloir défendre l’État de droit en contournant les exigences fondamentales, la transparence, la précision, la responsabilité.
Il aurait fallu ici du courage, pas de l’élégance. Du droit, pas du vernis.
C’est donc là tout le nœud tragique ou comique, selon qu’on lit la scène en juriste ou en dramaturge : le Barreau, dans son ambition de restaurer la dignité du droit, s’égare dans un exercice diplomatique où chaque mot est pesé non pour sa justesse, mais pour sa capacité à ne déranger personne.
Il devient ce funambule au verbe circonspect, marchant sur le fil ténu entre posture morale et compromission feutrée.
Un Barreau en contradiction avec lui-même
À vouloir incarner la sagesse, il trahit le courage. À dénoncer les dérives sans nommer les dériveurs, il finit par défendre l’État de droit sans jamais vraiment en rappeler les fondations.
L’article 1er du devoir d’un Barreau, s’il en existait un code moral dirait sans doute : « Ne pas travestir la justice par le silence ou l’équivoque ».
Mais ce code semble être resté dans un tiroir, avec la clé rangée sous un tapis de prudence.
Enfin , comment réclamer l’indépendance de la justice tout en détournant pudiquement les yeux des appels à la violence par des visages politiques ?
Comment appeler au droit tout en négligeant la défense explicite des institutions qu’il fonde ?
Comment parler de paix quand on refuse d’interpeller ceux qui jouent de la division comme d’un violon électoral ?
En définitive, le Barreau ne défend pas ici l’État de droit : il défend l’idée qu’on peut le faire à moitié. Il plaide, mais sans plaidoirie. Il dénonce, mais sans désigner. Il avertit, mais sans nommer.
Il est temps que le Barreau assume pleinement son rôle de vigie de la démocratie, en dénonçant sans ambages les dérives, d’où qu’elles viennent, et en soutenant activement les institutions qui œuvrent pour la préservation de l’État de droit. C’est à ce prix qu’il pourra véritablement contribuer à une élection présidentielle apaisée et équitable en 2025.
Kalilou Coulibaly Doctorant EDBA, Ingénieur