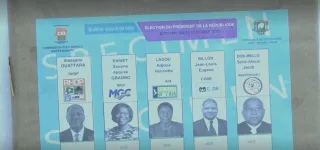Dans cette logique, l’accès à l’école pour tous les enfants de Côte d’Ivoire fonde la trame des différents plans d’actions initiés par les pouvoirs publics. Ainsi, en 2015, le gouvernement Ivoirien, à travers la loi 2015-635 du 17 septembre 2015 a institué la scolarisation obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans en mettant l’accent sur la scolarisation de la jeune fille. Le constat, bien avant la mise en œuvre de cette mesure, était que les filles, sous l’influence des pesanteurs socioculturelles étaient moins scolarisées. L’effet de la loi citée plus haut, a entrainé une réforme profonde du système scolaire ivoirien avec la construction d’une centaine de lycées et collèges à travers le pays, notamment les collèges de proximité dans l’optique d’offrir la possibilité à tous les enfants en âge d’aller à l’école de bénéficier de l’instruction et d’une formation de base.
Mais, l’insuffisance des infrastructures n’était pas l’unique tare de l’école ivoirienne. Il y’avait également la problématique des grossesses en cours de scolarité. En 2012, les chiffres du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique indiquait 5076 cas de grossesses chez les élèves du cycle primaire et secondaire premier et second cycle. Aucune région scolaire n’était épargnée. Pour réduire ce phénomène inquiétant, outre la construction d’infrastructures scolaires, l’Etat ivoirien, à travers le Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, a mis en place en 2014, un plan accéléré de réduction des grossesses en milieu scolaire. Ce plan adopté en conseil des ministres le 02 avril 2014, comporte parmi ses actions stratégiques une campagne nationale « Zéro grossesse à l’école » dont la première édition a été lancée le 28 février 2014 par l’ex-Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, à Bondoukou (Nord-Est). Il a également institué la création d’un club de lutte contre les grossesses et les infections sexuellement transmissibles dans chaque établissement scolaire (Gogoua, 2015).
Une décennie plus tard, l’on est stupéfait de savoir que le nombre de cas de grossesses identifiés en milieu scolaire reste encore élevé. Pour l’année scolaire 2024-2025, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) dans son Rapport national 2024-2025 tire sur la sonnette d’alarme en révélant que 4481 cas de grossesses en milieu scolaire ont été enregistrés. Le tableau de ce rapport montre que toutes les régions sont concernées. La Nawa présente le plus fort taux avec 424 cas de grossesses, suivis du Tonkpi 300 cas, de la Marahoué 267 cas. Le Ministère de l’Education Nationale de son côté, avance le chiffre de 4126 cas de grossesses en milieu scolaire pour la même année scolaire. Aussi, dans le parcours de la lutte contre ce fléau, la conceptualisation a connu une mutation, car de grossesses en milieu scolaire dans les années 2013-2013, l’on évoque désormais le concept de grossesses en cours de scolarité. Dans tous les cas de figures, ce fléau compromet les objectifs nationaux d’égalité des chances et de scolarisation universelle. Derrière chaque grossesse se cache une trajectoire scolaire interrompue, une jeune fille vulnérabilisée, et bien souvent, un avenir compromis.
Les causes sont multiples : Elles vont de la pauvreté, qui pousse certaines adolescentes à rechercher un soutien financier auprès d’adultes (enseignants, commerçants, « tonton-gars »), à l’absence de dialogue dans les familles sur les questions de sexualité, en passant par la carence de dispositifs d'accompagnement psychologique et pédagogique dans les établissements scolaires. À cela s’ajoute la stigmatisation sociale, qui pousse de nombreuses jeunes filles enceintes à abandonner les cours de façon précoce, faute de soutien et de compréhension.
Sous l’angle sociologique, la problématique des grossesses en milieu scolaire ou en cours de scolarité n’est nullement un simple fait individuel, mais un problème structurel, au croisement de la précarité, des rapports de genre, de la sexualité juvénile et de l’organisation du système éducatif. En effet, cette problématique peut être analysée comme le produit d’un environnement social et scolaire qui reste peu protecteur vis-à-vis des adolescentes. L'absence d’éducation complète à la sexualité, le silence des familles sur les enjeux corporels et affectifs dicté par des pesanteurs culturelles, la pression des normes genrées, ainsi que les rapports de pouvoir asymétriques (entre élèves et adultes notamment), constituent des facteurs de vulnérabilité avérés (Bozon, 2009 ; Koné, 2021). Il est par ailleurs documenté que la pauvreté des parents qui crée un environnement de précarité chez les élèves parfois livrées à elles-mêmes et la favorise les relations de type transactionnel entre élèves et adultes, y compris dans l’environnement scolaire (ILO, 2018). Malgré l’instauration, en 2015, d’un code d’éthique qui donne la possibilité de sanctionner ceux des enseignants qui sont identifiés comme auteurs de cas de grossesses chez les élèves, des enseignants ou personnels encadrants sont directement impliqués dans certains cas ; ce qui pose la question de la gouvernance scolaire et de la responsabilité institutionnelle.
Face à cette réalité sociale, la responsabilisation des élèves est importante, mais elle ne peut se faire sans un cadre éducatif adapté. C’est pourquoi, nous suggérons l’introduction effective de l’éducation complète à la sexualité dans les programmes scolaires, comme le recommande l’UNESCO. Cette éducation ne doit pas se limiter à la biologie ou à la prévention des maladies, mais aborder aussi les questions de consentement, de respect du corps, de pression sociale et de projet de vie. Il est également urgent de renforcer les mécanismes de signalement et de sanction des cas d’abus sexuels en milieu scolaire, intensifier les campagnes de sensibilisation et d’éducation à la sexualité en fléchissant les pesanteurs socioculturelles par l’implication des acteurs communautaires et même religieux.
La grossesse ne doit pas être une condamnation définitive à l’échec. il est donc important de créer de véritables conditions de réintégration scolaire des jeunes mères. Les établissements doivent prévoir des dispositifs de retour à l’école, appuyés par des politiques d’accompagnement social, familial et communautaire.
Soutenir les filles, c’est protéger l’avenir du pays. Une école sûre, inclusive et équitable est l’un des leviers les plus puissants pour briser le cycle de la pauvreté et de la dépendance. La lutte contre les grossesses scolaires ne doit donc pas être vue comme un combat isolé, mais comme une exigence nationale.
Docteur OUATTARA Kalilou
Sociologue, Université Félix Houphouët-Boigny