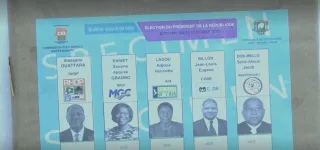Selon le Word Drug Ruport 2025 de l’UNODC, 2023, environ 316 millions de personnes âgées de 16 à 64 ans. Les substances les plus consommées sont le cannabis, les opioïdes, les amphétamines. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère la consommation de drogues comme un problème de santé publique.
Le continent africain n’est nullement épargné par ce fléau qui devient de plus en plus sophistiqué. En effet, les mêmes sources indiquent que, bien que les pays d’Afrique ne se situent pas traditionnellement sur les principaux itinéraires de trafic de drogues, les groupes criminels se tournent de plus en plus vers ce continent pour procéder au transbordement de cocaïne, d’héroïne et de méthamphétamine. Ainsi, le trafic de ces drogues à destination et en provenance de l’Afrique a augmenté au cours des trois dernières décennies. La cocaïne, dont on pensait auparavant qu’elle ne faisait que transiter par la région, y est de plus en plus consommée, ce qui se traduit par une augmentation du nombre de personnes entamant un traitement pour cette raison. Dans certains pays, la cocaïne est même devenue la drogue dont l’usage est le plus fréquemment déclaré par les femmes qui suivent un traitement. Par ailleurs, l’héroïne continue de pousser un nombre considérable de personnes à suivre un traitement en Afrique du Nord et en Afrique de l’Est, ainsi que dans certaines parties de l’Afrique australe.
Comme si ces drogues classiques ne font plus effet, de nouvelles formes de stupéfiants conçues de manière artisanale peut-on dire, ont fait leur apparition sur le marché de la drogue. Ces nouvelles drogues sont le plus souvent des mélanges nocifs de produits pharmaceutiques tels que le tramadol, les benzodiazépines, l’alcool et des solvants.
Chaque pays a ses spécificités. En République Démocratique du Congo par exemple, c’est la bourbée ; en République de Guinée c’est le kush. Dans d’autres régions d’Afrique ces drogues sont connues sous le nom de karkoubi ou nyaope. L’usage de ces substances constitue un phénomène de plus en plus préoccupant au regard des conséquences sanitaires, sociales, sécuritaires…
La Côte d’Ivoire, notre pays, est tout aussi profondément touché par la consommation et la circulation de drogues de tout genre. En effet, au cours de cette dernière décennie, les « fumoirs » et autres espaces de consommation ont métastasés. Outre les grands centres urbains comme Abidjan, Bouaké ou San Pedro, la quasi-totalité des villes ivoiriennes et nombreuses localités en zone rurale sont confrontées au phénomène de consommation des drogues. Les données du Comité interministériel de lutte antidrogue (CILAD) font état d’une croissance inquiétante de la consommation de cannabis, de tramadol, de cocaïne, et de drogues de synthèse comme la « Kadhafi ».
Le profil des consommateurs s’est élargi, car en dehors des jeunes-adultes marginalisés, l’on observe une banalisation de l’usage chez les mineurs et les adolescents, parfois dès l’âge de 11 ou 12 ans (UNODC, 2021). Pour endiguer ce fléau qui impacte négativement l’équilibre de l’écosystème ivoirien, le Gouvernement n’a de cesse œuvrer à la mise en place de mécanismes de lutte contre la circulation et la consommation des drogues à travers la synergie d’actions du Comité interministériel de lutte antidrogue CILAD, de la Direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues (DPSD), Cellule Anti-Drogue de la Gendarmerie nationale. A côté de ces structures qui interviennent dans la répression, il y’a aussi des instances de prise en charge et d’accompagnement des personnes en contact avec l’usage de la drogue. L’on peut citer le Programme National de Lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions (PNLTA), le Centre d’accompagnement et de soins en addictologie (CASA), la Croix Bleue, le Programme national de Thérapie de Substitution aux Opiacés (TSO) lancé en février 2025. Chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’abus et le trafic illicite de drogue célébrée chaque 26 juin, le Gouvernement réaffirme son engagement à apporter une réponse efficiente à ce fléau à travers le message lu par le ministre de l’intérieur et de la sécurité le Général de division Vagondo Diomandé.
Pour le sociologue, la consommation de la drogue dans nos cités constitue aujourd’hui un fait social majeur, dont l’ampleur et la complexité exigent une approche multidimensionnelle. Si les réponses institutionnelles ont longtemps été centrées sur les aspects sécuritaires et répressifs, il devient impératif pour la société tout entière de reconsidérer ce phénomène comme le symptôme de dysfonctionnements sociaux profonds.
La diffusion croissante des drogues, notamment dans les zones urbaines à forte densité démographique, s’inscrit dans un contexte marqué par le chômage structurel des jeunes, la précarité des familles, l’érosion des mécanismes traditionnels de socialisation, ainsi que l’effritement des valeurs collectives. L’espace social ivoirien, traversé par des inégalités persistantes, offre un terreau favorable à l’émergence de pratiques addictives qui apparaissent, pour nombre d’individus, comme des formes d’échappatoire ou de résistance symbolique face à l’exclusion sociale.
Cette expansion ne peut être dissociée de l’environnement social dans lequel elle s’inscrit. En contexte de précarisation généralisée, les drogues remplissent plusieurs fonctions sociales : elles servent à amortir la douleur psychique liée à l’exclusion, à renforcer une appartenance à des groupes affinitaires, ou encore à offrir une illusion de performance ou d’évasion dans des existences marquées par l’absence de perspectives.
Dans ce contexte, les « fumoirs » ne doivent pas être perçus uniquement comme des lieux de déviance, mais aussi comme des espaces de regroupement identitaire, où s’expriment des formes de marginalité et de quête de reconnaissance sociale. La banalisation de l’usage de drogues chez les adolescents, parfois dès l’âge du collège, interroge non seulement l’efficacité des dispositifs de prévention, mais également la capacité des institutions éducatives, familiales et religieuses à jouer leur rôle de médiateurs sociaux.
Face à cette réalité, nous pensons que la lutte contre la drogue ne saurait être exclusivement coercitive. Elle doit reposer sur trois axes complémentaires : la prévention socio-pédagogique, la prise en charge médico-psychosociale des usagers, et la réintégration socio-économique des jeunes en situation de rupture. Il s’agit de concevoir des politiques publiques inclusives, fondées sur une connaissance fine des dynamiques locales, et appuyées par des recherches empiriques menées en collaboration avec les acteurs communautaires.
Il est également essentiel de déconstruire les représentations stigmatisantes associées aux usagers de drogues. Ceux-ci ne doivent pas être réduits à leur consommation, mais compris dans leur parcours de vie, souvent jalonné de vulnérabilités accumulées. L’approche sociologique invite ainsi à considérer la drogue non comme un fléau isolé, mais comme un révélateur des fragilités sociales de notre société.
En définitive, la lutte contre la drogue en Côte d’Ivoire nécessite une réforme en profondeur de nos cadres d’analyse et d’action. Elle appelle à une mobilisation intersectorielle, intégrant la recherche sociale, les politiques de jeunesse, la santé publique, et la participation active des communautés. C’est à cette condition, nous le pensons fermement, que pourra émerger une réponse à la hauteur des enjeux posés par ce phénomène en constante mutation.
Docteur OUATTARA Kalilou Sociologue,
Université Félix Houphouët-Boigny